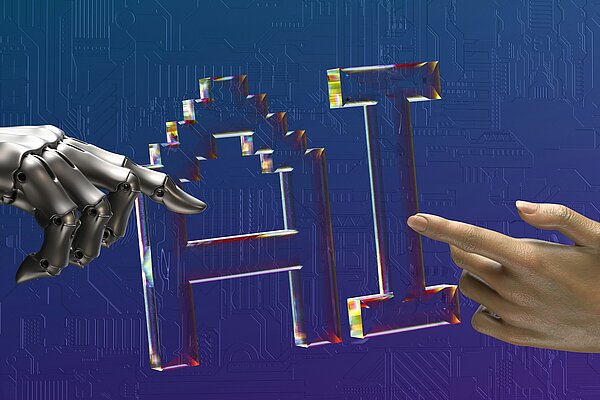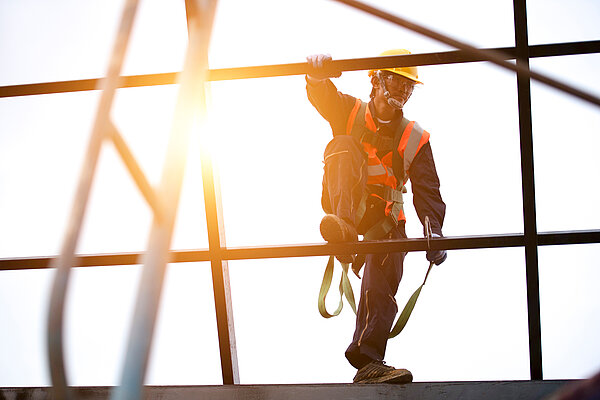Les cas de recours au CDD
Le CDD est un outil juridique strictement encadré par le Code du travail. Pour être valable, il doit répondre à deux exigences fondamentales : être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et ne pas avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (C. trav., art. L. 1242-1).
Exemple jurisprudentiel :
La Cour de cassation a rappelé que le recours massif et répété aux CDD ne peut pas servir à maintenir une main-d’œuvre flexible au détriment de l’obligation d’utiliser le CDI. Dans une affaire concernant un EHPAD, l’établissement avait conclu 870 CDD pour des postes d’agents de vie sociale et 322 pour des aides-soignantes, dont 388 contrats seulement pour quatre salariés. Ces CDD représentaient un quart des effectifs totaux de l’établissement.
La Cour a estimé que, au regard du nombre de contrats, de leur durée cumulée, de la nature des emplois et de la structure des effectifs, aucune justification objective ne permettait de qualifier ces besoins de temporaires. Cette situation révélait donc une volonté de l’employeur de disposer d’une main-d’œuvre flexible (Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-83.574).
Les cas de recours interdits

Le législateur a expressément exclu certaines hypothèses, dans lesquelles il est strictement interdit de conclure un CDD :
pour remplacer un salarié gréviste ;
pour effectuer des travaux particulièrement dangereux, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail ;
dans les six mois suivant un licenciement économique (sauf exceptions très limitées, telles qu’un contrat de trois mois maximum ou une commande exceptionnelle à l’exportation).
Les cas de recours autorisés
À l’inverse, plusieurs situations permettent légalement de recourir au CDD. Il s’agit notamment des cas suivants :
- Le remplacement d’un salarié absent
L’employeur peut conclure un CDD pour pallier l’absence ou la suspension du contrat de travail d’un salarié. Cela peut aussi concerner l’attente du recrutement d’un salarié en CDI, ou encore la suppression d’un poste effective dans les 24 mois. Le remplacement peut également intervenir lorsqu’un salarié passe temporairement à temps partiel.
À noter qu’un salarié recruté en CDD n’est pas nécessairement affecté au poste exact du salarié absent : il peut remplacer indirectement par un jeu de permutation de postes au sein de l’entreprise.
- Les emplois à caractère saisonnier
Un autre cas de recours est celui des emplois saisonniers, dont les tâches se répètent chaque année en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective (ex. vendanges, stations balnéaires ou de ski).

L’accroissement temporaire d’activité
L’employeur peut également recourir au CDD pour faire face à une augmentation ponctuelle de l’activité habituelle de l’entreprise (C. trav., art. L. 1242-2, 2°). Cette notion englobe plusieurs situations, telles que :
- un surcroît temporaire d’activité ;
- une commande exceptionnelle à l’exportation ;
- l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ;
- des travaux urgents rendus nécessaires par des impératifs de sécurité.
- Les CDD d’usage
Dans certains secteurs définis par la loi, la convention collective ou par un décret (spectacle, restauration, etc.), il est d’usage constant de recourir au CDD. Pour être valable, le CDD d’usage doit répondre à deux critères : la nature temporaire de l’emploi et l’appartenance à un secteur où l’usage est reconnu.
- Les CDD à objet défini
Réservé aux ingénieurs et cadres, ce type de CDD d’une durée de 18 à 36 mois (non renouvelable) a pour objet l’accomplissement d’une mission précise. Le contrat prend fin à la réalisation de l’objet, avec un délai de prévenance de deux mois. La rupture anticipée est possible après 18 ou 24 mois, mais seulement pour un motif réel et sérieux.
Les règles générales du CDD :
L’exigence de la forme écrite
Le CDD doit impérativement être conclu par écrit et remis au salarié dans les deux jours suivant l’embauche. Le contrat doit comporter certaines mentions obligatoires, notamment :
le motif du recours au CDD,
le terme du contrat ou, à défaut, une durée minimale,
la désignation du poste occupé et des tâches confiées.
À défaut d’écrit ou si l’une des mentions essentielles est omise, le contrat est automatiquement requalifié en CDI. Dans ce cas, l’ensemble des règles applicables au CDI s’impose à l’employeur.
L’égalité de traitement avec les salariés en CDI
La loi impose une égalité de traitement entre salariés en CDD et salariés en CDI. Cela concerne notamment la rémunération : un salarié en CDD doit percevoir une rémunération équivalente à celle d’un salarié en CDI occupant un poste similaire, avec la même qualification. L’égalité s’applique également en matière de droits collectifs (accès aux équipements, activités sociales du CSE, etc.).
Vous souhaitez en apprendre davantage sur les bases du droit du travail ? Formez-vous avec CELIADE !
Je me formeLe terme du contrat
Le CDD peut être conclu avec un terme précis ou imprécis.
Terme précis : le contrat prend fin à la date convenue. La durée maximale d’un tel CDD est en principe de 18 mois renouvellement inclus, sauf exceptions. Le contrat peut être renouvelé deux fois, sauf accord de branche étendu contraire.
Terme imprécis : le contrat prend fin à la réalisation de l’événement prévu, le plus souvent le retour du salarié remplacé. Dans ce cas, le contrat doit obligatoirement prévoir une durée minimale d’engagement.
Le délai de carence entre deux CDD
À l’expiration d’un CDD, l’employeur ne peut pas conclure immédiatement un nouveau CDD sur le même poste : un délai de carence doit être respecté.
Ce délai est égal au tiers de la durée totale du contrat, renouvellement compris. Pour les CDD d’une durée inférieure à 15 jours, il est réduit à la moitié de la durée du contrat.
Toutefois, la loi prévoit plusieurs exceptions : aucun délai de carence n’est requis pour les emplois saisonniers, les CDD d’usage, les travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, ou encore en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. De même, si le salarié recruté en CDD de remplacement rompt son contrat de manière anticipée ou refuse un renouvellement, le délai de carence ne s’applique pas. Enfin, un accord de branche étendu peut prévoir d’autres dérogations.
La fin du CDD :
L’expiration du terme
Le CDD prend fin automatiquement à l’arrivée de son terme, sans qu’aucune formalité particulière ne soit nécessaire. Durant la période d’essai, il peut être rompu unilatéralement par l’une ou l’autre des parties.
Les cas de rupture anticipée
Bien que le principe soit l’exécution du CDD jusqu’à son terme, la loi admet plusieurs exceptions permettant une rupture anticipée :
Par le salarié en cas d’embauche en CDI : le salarié peut rompre son CDD de manière anticipée s’il justifie d’une embauche en CDI. Il doit alors exécuter un préavis d’un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, sans excéder deux semaines, sauf accord entre les parties.
Par l’employeur en cas d’inaptitude physique : si l’inaptitude du salarié est médicalement constatée, et après que l’employeur a rempli son obligation de reclassement, le CDD peut être rompu. Le salarié bénéficie alors d’une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement (portée au double si l’inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle).
En cas de force majeure : un événement imprévisible, irrésistible et extérieur peut justifier la rupture anticipée du contrat.
En cas de faute grave du salarié : l’employeur peut rompre le contrat si une faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Dans ce cas, la procédure disciplinaire doit être respectée.
Par accord des parties : les deux parties peuvent convenir de mettre fin au contrat avant son terme. Cet accord doit impérativement être constaté par écrit.

En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, toute rupture anticipée ouvre droit à des dommages et intérêts. En effet, attention, il n’est pas possible de démissionner d’un CDD !
Si la rupture est imputable au salarié, l’employeur peut obtenir une indemnisation correspondant au préjudice subi.
Si la rupture est imputable à l’employeur, le salarié a droit à une indemnisation équivalente aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, à l’indemnité de précarité, et éventuellement à des dommages et intérêts complémentaires pour préjudice distinct.
Vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet ? contactez dès aujourd'hui nos juristes !
Contactez-nous !Les indemnités de fin de contrat
L’indemnité de précarité : sauf exceptions, le salarié en CDD a droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération brute totale perçue. L’indemnité n’est pas due dans certaines situations : CDD saisonnier, CDD de remplacement suivi d’un CDI, refus par le salarié d’une proposition en CDI, rupture anticipée à l’initiative du salarié, faute grave ou force majeure.
L’indemnité de congés payés : le salarié en CDD bénéficie également d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours non pris.
Recevez toute l'actualité juridique !