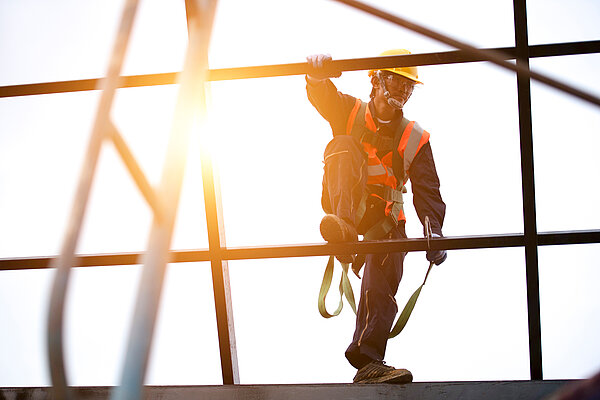Dans l’entreprise, les élus du CSE sont souvent les premiers à être sollicités lorsqu’un salarié dénonce une situation de harcèlement sexuel, moral ou de discrimination. Leur rôle est essentiel : écouter, alerter, accompagner. Mais comment agir sans se tromper ?
Si le Code du travail ne rend pas obligatoire l’enquête interne, elle demeure un outil précieux pour comprendre les faits, prévenir les dérives et rétablir un climat de confiance. Encore faut-il qu’elle soit conduite avec méthode. Une enquête improvisée ou biaisée peut non seulement aggraver la souffrance des personnes, mais aussi fragiliser la défense de l’entreprise.
C’est pour répondre à ces enjeux que la Défenseure des droits a publié la décision-cadre n° 2025-019, intitulée « Discrimination et harcèlement sexuel dans l’emploi privé et public : recueil du signalement et enquête interne ». Ce texte n’a pas de valeur contraignante, mais il propose une véritable boussole méthodologique, utile aux employeurs et aux représentants du personnel.
Et même si cette décision-cadre cible le harcèlement sexuel, ses principes peuvent s’appliquer, selon nous, aux enquêtes relatives au harcèlement moral ou à la discrimination.
Créer la porte d’entrée : un dispositif d’écoute visible et crédible
Le premier pilier d’une démarche efficace, c’est de permettre aux salariés de signaler une situation en toute confiance.
La Défenseure des droits recommande que chaque entreprise mette en place un ou plusieurs canaux clairs de signalement, pouvant prendre la forme :
d’une personne ressource identifiée (référent harcèlement sexuel, référent diversité, etc.) ;
d’un dispositif interne transparent, porté à la connaissance de tous les salariés ;
ou d’un prestataire extérieur garantissant la neutralité du traitement des signalements.
Encore trop souvent, ces dispositifs existent sur le papier, mais demeurent invisibles dans la vie quotidienne. L’affichage, l’intranet, le livret d’accueil ou les réunions d’équipe doivent les rendre concrets et accessibles.
Des interlocuteurs formés, neutres et protecteurs
Le signalement doit pouvoir être adressé à différents interlocuteurs – hiérarchie, RH, référent harcèlement, représentants du personnel ou médecin du travail – sans conséquence sur son traitement.
La Défenseure des droits préconise de distinguer deux structures complémentaires :
La cellule d’écoute, lieu d’accueil, d’information et d’orientation des victimes ou témoins. Elle les informe sur leurs droits (internes, civils, pénaux) et les oriente vers des acteurs spécialisés (médecine du travail, associations, services sociaux…).
Le dispositif de signalement, qui a une portée juridique : il engage l’employeur à traiter le signalement conformément aux articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du Code du travail.
Recueillir la parole : écoute, respect et traçabilité

Lorsqu’un salarié dépose un signalement, la réaction immédiate de l’entreprise est décisive.
La Défenseure des droits recommande d’accuser réception rapidement, en rappelant à la personne ses garanties : confidentialité, absence de représailles, et information sur les suites données.
Les signalements anonymes ne doivent pas être écartés d’emblée : s’ils sont suffisamment circonstanciés, ils doivent être examinés. L’anonymat n’enlève rien à la crédibilité d’un témoignage.
L’élu du CSE qui reçoit un signalement peut aussi encourager la rédaction d’un écrit, utile à la fois pour sécuriser la preuve et pour structurer l’enquête.
Réagir vite, sans attendre la justice
La célérité est un principe essentiel. La Cour de cassation (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975) rappelle que si les faits sont établis, l’employeur doit agir immédiatement sans attendre d’enquête. Mais si les faits nécessitent vérification, l’enquête interne doit être ouverte sans délai.
La Défenseure des droits insiste sur plusieurs points :
le délai entre les faits et le signalement n’exonère pas l’employeur d’enquêter ;
il ne faut pas attendre le résultat d’une procédure pénale ou civile pour agir ;
une enquête peut être menée même si la victime ou l’auteur présumé est en arrêt maladie ou a quitté l’entreprise.
L’enjeu : montrer que l’entreprise réagit, protège et agit avec discernement.
Développez vos connaissances et apprenez comment agir face à une situation d'harcèlement autour de vous !
Je me formeProtéger sans punir : un équilibre à trouver

L’ouverture d’une enquête ne doit pas conduire à ignorer la souffrance.
La Défenseure des droits recommande de prendre en compte l’état de santé de la victime présumée, d’anticiper son retour et de proposer un échange sur les mesures de protection possibles.
Mais la protection concerne aussi le mis en cause : lui aussi peut souffrir du climat d’enquête. C’est pourquoi les coordonnées du médecin du travail doivent être transmises à toutes les parties, dès le début du processus.
Enfin, la protection doit être effective : il est préférable de modifier les conditions de travail du mis en cause, plutôt que celles de la victime, afin d’éviter toute mesure assimilable à des représailles.
Enquêter, oui - mais dans les règles
Le Code du travail ne fixe pas de procédure type. La Défenseure des droits invite donc les employeurs à formaliser une méthodologie d’enquête après consultation du CSE.
Chaque étape doit être tracée par écrit pour garantir la transparence et la vérifiabilité, que ce soit par un juge, l’inspection du travail ou la Défenseure des droits.
Le principe de confidentialité doit être rappelé à tous, via une attestation signée par les personnes auditionnées et les enquêteurs.
L’enquête doit être collégiale, menée par au moins deux personnes aux profils complémentaires.
Il est préférable que les représentants du personnel soient associés à l’enquête. Cela est même obligatoire s’ils sont à l’origine du signalement, conformément aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail.
Enfin, la Défenseure des droits met en garde contre toute pression exercée par l’employeur sur les enquêteurs : l’impartialité est une exigence de légitimité.
Contactez nos juristes pour avoir toutes les questions à vos réponses !
Contactez-nous !Les auditions : donner la parole à tous, dans un cadre sécurisé
L’audition est un moment clé. Doivent être entendus : la victime présumée, le mis en cause, les témoins directs ou indirects, ainsi que les responsables hiérarchiques.
Le mis en cause est entendu en dernier. Si la victime ou lui-même est en arrêt maladie, l’audition doit tout de même être proposée.
Les entretiens doivent se tenir dans un lieu garantissant la confidentialité : exit les open-spaces ou la salle de pause... La personne entendue peut être accompagnée par un représentant du personnel, un interprète, ou un avocat - à condition que celui-ci reste en retrait.
Le rapport d’enquête : rigueur et transparence

Le rapport final doit retracer l’ensemble du processus :
les faits, les mesures de protection, les auditions, les difficultés rencontrées, les éléments de preuve, les réponses du mis en cause, et la proposition de qualification juridique des faits.
Il est conservé par l’employeur pour garantir la confidentialité, mais une synthèse doit être communiquée à la victime présumée – faute de quoi elle pourrait douter du sérieux de la démarche.
Cette synthèse expose la méthodologie, les conclusions et les décisions prises, sans révéler les identités ni les témoignages.
Les représentants du personnel peuvent recevoir une version anonymisée, avec l’accord des personnes concernées.
Qualifier les faits : le dernier mot revient à l’employeur
L’enquêteur éclaire, mais c’est l’employeur qui qualifie juridiquement les faits et décide des suites disciplinaires.
La Défenseure des droits insiste sur la nécessité d’une formation juridique solide pour les enquêteurs et les décideurs. L’employeur peut, à ce stade, solliciter un conseil juridique ou un avocat.
En conclusion : agir, protéger, respecter
Cette décision-cadre du Défenseur des droits n’impose rien - elle recommande. Mais derrière ces recommandations se dessine une véritable feuille de route pour les entreprises et les élus du CSE. Inspirée par les principes du droit et guidée par l’éthique, elle trace les repères essentiels d’une enquête interne respectueuse, efficace et humaine.
Les élus du CSE, déjà en première ligne lorsqu’ils exercent leurs droits d’alerte (voir notre article dédié : https://celiade.com/actualites/article/les-droits-dalerte-ducse ), trouveront ici une boussole précieuse pour concilier protection des personnes, équité procédurale et conformité juridique.
Recevez toute l'actualité juridique !