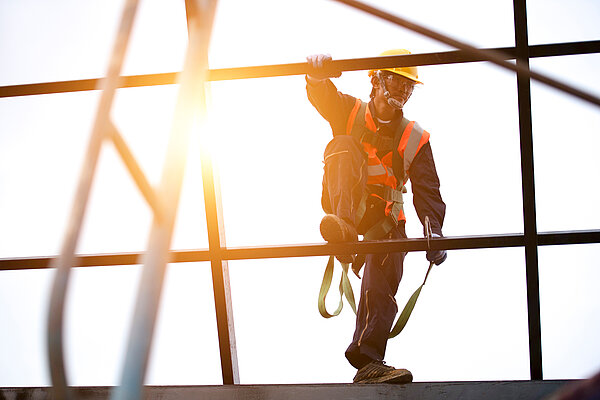Avant le 10 septembre 2025 : une jurisprudence défavorable au salarié

Jusqu’à ce revirement, la règle était claire : un salarié malade pendant ses congés payés ne pouvait pas récupérer ses jours perdus. La Cour de cassation estimait que l’employeur, en accordant les congés payés, avait rempli son obligation, peu importe que la maladie empêche le salarié d’en profiter. Concrètement, lorsqu’un salarié se trouvait déjà en congé payé puis tombait malade, c’était la suspension du contrat au titre des congés payés qui primait sur celle liée à l’arrêt maladie.
Dans ce schéma, le salarié touchait bien son indemnité de congé payé, parfois cumulée avec les indemnités journalières de sécurité sociale, mais sans possibilité de reporter ses congés.
Une position contraire au droit européen
Cette solution française s’éloignait du droit européen. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que le congé payé a une finalité propre : le repos et la détente du salarié, tandis que l’arrêt maladie vise le rétablissement. Ces deux temps ne sont donc pas interchangeables (CJCE 20 janv. 2009, aff. C-350/06 ; CJUE 21 juin 2012, aff. C-78/11) !
Pour l’Union, priver un salarié malade pendant ses congés de tout report revient à le priver d’un droit fondamental. Cette divergence a conduit la Commission européenne à mettre en demeure la France, en juin 2025, d’adapter sa législation.
Le revirement du 10 septembre 2025
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation change de cap (Cass. soc., 10 sept. 2025, n°23-22.732). Elle juge désormais que l’article L. 3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003, permet au salarié de reporter ses congés payés en cas de maladie survenant pendant ceux-ci.
Les conséquences pratiques pour les salariés

Un salarié malade pendant ses congés n’est plus lésé. Ses jours ne sont pas perdus et il pourra les reprendre plus tard. Mais ce droit n’est pas automatique : il suppose de respecter certaines formalités, notamment fournir un certificat médical et transmettre l’arrêt à l’employeur dans les délais.
L’employeur doit, à son tour :
calculer le nombre de jours de congé payé reportés ;
informer le salarié, dans le mois suivant sa reprise, du solde disponible et de la date limite à laquelle ces congés peuvent être pris (art. L. 3141-19-3 du Code du travail).
Deux situations se présentent ensuite :
Période de congés en cours : l’employeur peut imposer la prise des jours reportés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.
Période expirée ou reliquat non soldé : le salarié dispose d’un délai supplémentaire de 15 mois pour poser ses jours, ce délai commençant à compter de la notification par l’employeur (art. L. 3141-19-1).
Cette règle s’applique également aux maladies survenues à l’étranger, dès lors que l’arrêt de travail est reconnu et notifié à l’employeur. Même sans indemnités journalières à l’étranger, le droit au report reste acquis.
Exemple concret : Imaginons Sophie, chargée de clientèle dans une société d’assurances, qui planifie ses vacances du 1er au 14 août. Le 3 août, elle attrape une grippe sévère et son médecin lui prescrit un arrêt maladie jusqu’au 10 août. Avant 2025, tous ses congés seraient considérés comme pris, et Sophie aurait perdu une semaine de vacances à cause de la maladie. Avec la nouvelle jurisprudence, elle peut désormais reporter les jours de congé correspondant à sa période d’arrêt (du 3 au 10 août) et les poser plus tard, sans perdre ses droits au repos.
Les obligations pour les employeurs
Cette évolution impose aux employeurs une adaptation immédiate de la gestion des congés :
Accepter la suspension des congés en cas de maladie notifiée, avec report des jours concernés.
Régulariser la paie, notamment si une indemnité de congé payé a été versée à tort.
En conclusion, congés payés gâchées par la maladie ? La Cour de cassation dit stop !
La Cour de cassation a enfin acté ce que le droit européen exigeait depuis des années : un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés ne doit pas perdre son droit au repos. Désormais, les congés payés et l’arrêt maladie ne se confondent plus.
Pour les salariés, c’est la promesse de congés payés préservés, même en cas de maladie. Pour les employeurs, c’est un vrai défi de gestion à anticiper. Mais au final, cette décision réaffirme que le repos du salarié n’est pas négociable et que le droit social français s’aligne enfin sur le droit européen.
Recevez toute l'actualité juridique !